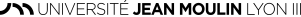Dans la même rubrique
Accueil :
- Accueil FR
- Publications
- Les fiches courtes
Les fiches de la Clinique 6/10
- Fiche n°48 - Le lanceur d'alerte en entreprise
-
Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte en entreprise ?
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, des informations relatives à un crime, un délit, ou un préjudice pour l’intérêt général commis dans l’entreprise.
Conditions d’application du régime du lanceur d’alerte
Qui peut obtenir le statut de lanceur d’alerte dans l’entreprise ?
- les salariés, anciens salariés et candidats à l'embauche ;
- les actionnaires, les associés et les titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale ;
- les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
- les collaborateurs extérieurs ou occasionnels ;
- les cocontractants de l'entreprise concernée, leurs sous-traitants ou les membres du personnel et de l'organe
- d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants.
Le lanceur d’alerte doit agir :
Sans contrepartie financière : Le lanceur d’alerte ne doit pas agir en échange d’une somme d’argent versée par quiconque ;
De bonne foi : Le lanceur d’alerte devait avoir des motifs raisonnables de croire, au moment du signalement, que les informations divulguées étaient véridiques, à la lumière des circonstances et des informations dont il disposait à cet instant.
Quels faits le lanceur d’alerte peut-il dénoncer ou divulguer ?
Il peut divulguer un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, des faits de harcèlement moral ou sexuel commis dans l’entreprise).
Lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre d’activités professionnelles, il n’est pas nécessaire que le lanceur d’alerte ait eu personnellement connaissance de ces faits. Il lui est donc possible de divulguer des informations qui lui ont été rapportées par une autre personne, comme par exemple un autre salarié de l’entreprise.
Attention : certaines informations et certains documents ne peuvent pas être divulgués, tels que ceux couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête, le secret de l’instruction judiciaire et le secret professionnel de l’avocat.
Quelle procédure faut-il suivre pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte ?
1- Depuis la dernière réforme, le lanceur d’alerte est libre de choisir de procéder par un signalement interne ou par un signalement externe.
Le signalement interne doit être effectué :
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés : le signalement peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci s’il n’existe aucune procédure particulière mise en place par l’entreprise afin de recueillir et traiter les signalements.
- Dans les entreprises de plus de 50 salariés : une procédure interne doit obligatoirement être mise en place, après consultation du CSE. Chaque entreprise détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à cette obligation.
Le signalement externe doit être effectué auprès de :
- De l’autorité spécialisée qui a été désignée compétente pour traiter de ce domaine par un décret (par exemple : lorsque l’alerte porte sur la protection de la vie privée et des données personnelles, le signalement externe doit être adressé à Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)).
- Du défenseur des droits qui oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
- De l’autorité judiciaire, c’est-à-dire, les magistrats et les juges qui sont compétents pour juger des litiges qui dépendent de l’ordre judiciaire (par exemple : le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal de commerce, la Cour d’Assises…). Sont exclus les magistrats qui composent l’ordre administratif (par exemple : le tribunal administratif).
- A l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union Européenne compétent s'agissant d'une violation d'un droit de l'Union européenne.
2- La divulgation publique n’est possible qu’après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, et si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement.
Cependant, un signalement public pourra directement intervenir dans certains cas limitativement énumérés, notamment si la saisine de l’autorité compétente fait courir un risque de représailles au lanceur d’alerte.
La protection accordée au lanceur d’alerte
Qui est protégé ?
- Le lanceur d’alerte ;
- Les facilitateurs : toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif qui aide le lanceur d’alerte à signaler et divulguer les informations ;
- Les personnes physiques, en lien avec un lanceur d’alerte, qui risquent de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client (par exemple : les collèges et proches du lanceur d’alerte);
- Les entités juridiques (par exemple : les sociétés ou associations) contrôlées par le lanceur d’alerte ou pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Quelles sont les mesures de protection ?
La garantie de confidentialité de l'identité :
Par principe, les éléments qui permettent d’identifier le lanceur d’alerte ne sont communiqués qu’avec le consentement de ce dernier, sauf exceptions (par exemple : lorsque la personne chargée du recueil des signalements est tenue de dénoncer les faits à l’autorité judiciaire).
L’Immunité civile et pénale du lanceur d’alerte :
- Le lanceur d’alerte n’est pas civilement responsable des dommages causés du fait de son signalement ou de sa divulgation publique dès lors qu'il avait des motifs raisonnables de croire que la communication de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
- Le lanceur d'alerte (comme ses complices) ne peut faire l’objet de poursuites pénales :
- Lorsqu’il porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ;
- Lorsqu’il vole ou détourne des documents qui contiennent les informations qu’il signale dans son alerte (article 122-9 du Code pénal).
La protection contre des mesures de représailles :
Les lanceurs d’alerte ne peuvent pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures par l’employeur.
Par exemple, sont désignées comme mesures de représailles la suspension, la mise à pied, le licenciement, la rétrogradation ou le refus de promotion, le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail…
Tout acte de représailles sera annulé par le juge, L’acte sera considéré comme n’ayant jamais existé et ses éventuelles conséquences seront réparées.
Des sanctions civiles et pénales spécifiques sont prévues pour la violation du statut protecteur du lanceur d’alerte :
Toute personne qui fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision peut être prononcée.
- Une amende civile d’un montant de 60 000 € peut être prononcée, sans compter l’octroi de dommages et intérêts à la victime, en cas de mise en œuvre d’une action en justice abusive ou dilatoire (c’est-à-dire initiée alors qu’aucun fondement juridique ne le justifie ou encore dans l’unique but de gagner du temps).
- L’employeur peut également être condamné à verser une somme majorée sur le Compte personnel de formation (CPF) du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, le salarié pourra saisir le Conseil de prud’hommes en référé, c’est-à-dire bénéficier d’une procédure accélérée devant cette juridiction afin de faire cesser la violation de ses droits dans un bref délai.
> Télécharger la fiche n°48 - Fiche n°47 - La procédure simplifiée du changement de nom de famille
-
Contexte
La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a non seulement modifié mais également allégé la procédure de changement de nom. Depuis le 1er juillet 2022, changer de nom ne nécessite plus obligatoirement de motif légitime, il n’est donc plus imposé de justifier la demande. Cette procédure, en plus d’être simplifiée, est gratuite.
Qui peut demander à changer de nom de famille ?
Aujourd’hui toute personne peut, dans sa vie, changer une fois son nom.
1- Par la procédure normale, toute personne de nationalité française invoquant un motif légitime (Pour plus de détails : Cf.fiche de la Clinique juridique n°19).
2- Par la procédure simplifiée, toute personne majeure ou mineure émancipée peut demander à changer de nom de famille pour prendre un nom issu de sa filiation (le nom de son père, de sa mère, ou les deux dans l’ordre souhaité).Exemple : Eline Dupont née de l’union de Sophie Durand et Pierre Dupont
pourra prendre les noms suivants :
Eline Durand / Eline Dupont-Durand / Eline Durand-Dupont.
La procédure simplifiée à suivre
ETAPE 1 : La constitution du dossier :
Il est nécessaire de télécharger le formulaire CERFA N°16229*01 en ligne ou de le retirer en mairie. Il faut alors remplir ce formulaire et préciser la demande. Il faudra joindre à ce formulaire certaines pièces justificatives :
- Une pièce d’identité en original ;
- Un acte de naissance de moins de 3 mois délivré par une autorité française (sauf si la demande est faite dans la mairie de lieu de naissance du demandeur) ;
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- Les actes à mettre à jour (acte de mariage, attestation de PACS, ou actes de naissance des enfants) ;
- S’il s’agit du changement de nom d’un mineur de plus de 13 ans : son accord écrit et sa pièce d’identité.
ETAPE 2 : Le dépôt du dossier à la mairie :
Le dépôt de la demande s’effectue soit en personne auprès d’un agent du service d’état-civil de la mairie du lieu de naissance ou du lieu de résidence, soit par courrier postal.
Attention, si vous résidez à l’étranger : il convient d’adresser la demande à l’ambassade ou au consulat de France ou même à la mairie de votre lieu de naissance si vous êtes né en France.
ETAPE 3 : L’étude du dossier :
Un agent du service d’état civil de la mairie auprès de laquelle la demande a été effectuée est chargé de vérifier que les conditions de la demande sont respectées. A défaut, le dossier est transmis au procureur de la République qui statuera sur la demande de changement de nom. Il est également possible de transmettre soi-même le dossier au procureur de la République lorsque l’officier d’état civil empêche le bon déroulement de la procédure. Si le dossier est complet, un récépissé est remis au demandeur. Ce récépissé confirme la démarche en cours et constitue le point de départ du délai de réflexion.
ETAPE 4 : Délai de réflexion et confirmation :
Un délai de réflexion de 30 jours qui ne peut être réduit est prévu. Une fois ce délai expiré, il importe de confirmer le souhait de changer de nom de famille auprès d’un agent de la mairie au sein de laquelle le dépôt du dossier a été effectué, en se rendant au sein de celle-ci, sans pour autant devoir prendre rendez-vous. Il faudra alors compléter et signer la dernière page du formulaire CERFA de la demande avec l’agent d’état civil, la confirmation de la volonté de changer de nom devant nécessairement se faire par écrit. Cette dernière doit intervenir dans un délai maximal de 45 jours. À défaut de confirmation dans ce délai, la demande est classée sans suite puis détruite par le service.
ETAPE 5 : Finalisation du changement :
À la suite de la confirmation, l’acte de changement de nom est édité et les registres de l’état civil sont mis à jour. La mairie adressera alors au demandeur un courrier de notification accompagné de l’acte de changement de nom ainsi que de l’ensemble des actes d’état-civil mis à jour. Le service d’état civil auprès de qui la demande a été faite s’occupe seul de faire le lien avec les mairies concernées par les mises à jour.
ETAPE 6 : Éventuelle contestation en cas de refus :
En cas de difficulté soulevée par l’officier d’état civil, le dossier est transmis au procureur de la République qui peut s’opposer au changement de nom. Ce refus opposé et motivé par le Procureur peut être contesté judiciairement. Il sera alors nécessaire d’engager un avocat.
Points de vigilance
- Le changement de nom de famille par la procédure simplifiée permet la modification de son état civil. Il est à distinguer du simple nom d’usage qui peut être utilisé dans la vie quotidienne mais qui n'apparaîtra pas sur les actes de l’état civil.
- Après que le changement de nom de famille est intervenu, c’est au bénéficiaire de celui-ci d’accomplir les démarches pour mettre à jour ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire notamment). Dans cette hypothèse, la demande visant à refaire la carte nationale d’identité, même si elle est encore en cours de validité, ne donne pas lieu au paiement de la taxe de 25 euros. Il ne sera pas non plus requis de payer le nouveau passeport. Il sera cependant nécessaire de joindre aux demandes la preuve du changement de nom (nouvel état civil).
- Il sera également important d’informer les administrations de ce changement afin de mettre à jour le nom de famille auprès de celles-ci (par exemple : le service des impôts, la sécurité sociale, banque, compagnie d’assurance, mutuelle, l’ANTS, pôle emploi, employeur, le bureau du service national pour les français âgés de moins de 25 ans, etc...)
> Télécharger la fiche n°47 - Fiche n°46 - Action en justice et association
-
Qu'est-ce qu'une action en justice ?
L’action en justice est un droit qui permet à quiconque de faire entendre ses prétentions devant un tribunal et de les discuter.
Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Toute association, valablement déclarée en préfecture, est une personne juridique dotée de la capacité d'agir en justice.
Qui peut représenter l'association ?
En droit des associations, les statuts, qui sont les règles de fonctionnement de l’association, sont essentiels. Ils définissent, notamment, l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge. La personne ainsi habilitée peut être tout membre de l’association à qui l’assemblée générale ou l’organe décisionnaire confie mandat pour exercer l’action en justice elle-même. Bien souvent, c’est le président. A défaut de disposition statutaire, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent (par défaut, ce sera l’assemblée générale).
Quelles sont les conditions à remplir ?
Une association doit remplir certaines conditions pour engager une action en justice : elle doit avoir la capacité, la qualité et un intérêt à agir.
→ Capacité à agir : c’est l’aptitude à faire valoir ses droits.
Toute association a la capacité d’agir en justice dès lors qu’elle est pourvue de la personnalité morale. Pour ce faire, elle doit avoir été régulièrement déclarée en préfecture et cette déclaration avoir été publiée au bulletin officiel. L’action qu’elle décide d’engager doit entrer dans l’objet social de l’association, c’est à dire dans l’activité pour laquelle elle a été constituée. L’action en justice doit donc entrer dans les buts et engagements poursuivis par l’association.
→ Intérêt à agir : un avantage doit pouvoir être procuré par l’action en justice.
L’association doit avoir un intérêt à agir en justice. Il doit être :
- Positif et concret : l’intérêt doit exister et il doit y avoir un minimum d’enjeu à l’exercice de l’action en justice.
- Né et actuel : l’intérêt doit exister au jour de l’action et ne doit pas être une éventualité.
- Légitime : l’association doit avoir un intérêt au succès ou au rejet de sa demande.
- Direct et personnel : l’association doit avoir subi un préjudice. Mais, si elle agit pour la défense d’intérêts collectifs de ses membres : elle n’a pas à justifier d’un préjudice direct et personnel.
→ Qualité à agir : l’action en justice nécessite de posséder un titre ou un droit particulier.
En principe, la démonstration d’un intérêt à agir suffit pour avoir la qualité à agir. Parfois, la loi peut directement habiliter une association à agir en justice, en lui conférant qualité à agir.
- Devant les juridictions civiles : L’action en justice est recevable si elle est compatible avec l’objet social de l’association.
- Devant les juridictions pénales : Si l’association a été habilitée par la loi, elle peut se constituer partie civile pour défendre des intérêts collectifs.
- Devant les juridictions administratives : L’association doit avoir voté la décision d’ester en justice en assemblée générale. Elle peut seulement défendre ses propres intérêts.
Quid de l'action collective ?
La Loi Hamon de 2014 permet aux associations de consommateurs victimes d’un même préjudice individuel d’obtenir réparation de ce dernier.
Certaines conditions sont toutefois requises pour cette action collective :
- Le manquement doit provenir d’un professionnel ;
- L’association doit être agréée (ce qui traduit une représentativité nationale) ;
- L’action doit être introduite dans les 5 ans à compter du jour où la victime a connu pu aurait dû connaitre des faits litigieux ;
- La représentation par un avocat est obligatoire
Ce n’est pas la seule action de groupe prévue en droit français. Il en existe, par exemple, en droit de la santé, droit de l’environnement, droit du travail et droit de la protection des données.
> Télécharger la fiche n°46
- Fiche n°45 - La résiliation judiciaire du contrat de travail
-
Qu’est-ce que c’est ?
La résiliation judiciaire est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Elle consiste à obtenir du juge qu’il prononce la rupture du contrat de travail en raison de manquements graves au contrat de travail commis par l’employeur.
Qui est concerné ?
La résiliation judiciaire ne peut pas être demandée par l’employeur, sauf exception légale pour les contrats d’apprentissage.
Le salarié ne peut pas demander la résiliation judiciaire de son contrat durant la période d’essai.
La demande de résiliation peut être déposée par un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) si l’employeur manque gravement aux obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire peut également être engagée par un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) mais uniquement en cas de faute grave de la part de l’employeur ou de force majeure.
Quels sont les hypothèses ?
Il faut que les manquements soient suffisamment graves et qu’ils rendent impossible la poursuite du travail par le salarié. Il appartient aux juges d’apprécier la gravité des faits invoqués pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Quelques exemples :- Non-paiement du salaire contractuellement prévu ;
- Heures supplémentaires impayées et dissimulation du travail réalisé ;
- Harcèlement moral ou sexuel ;
- Manquement à la protection de la santé du salarié.
Quelle est la procédure à suivre ?
Le salarié doit saisir le conseil des prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le bureau de jugement du conseil des prud’hommes sera directement saisi de l’affaire et devra statuer dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Par principe, le contrat de travail se poursuit normalement pendant l’instance prud’homale, jusqu’au prononcé du jugement. Les juges apprécient les manquements imputés à l’employeur au jour de la décision. En d’autres termes, si ces manquements ont disparu du fait de leur régularisation par l’employeur, la résiliation judiciaire n’est plus justifiée.
Le salarié dispose de deux ans à compter du fait fautif reproché à l’employeur pour faire sa demande de résiliation judiciaire.
Quels sont les effets ?
Il y a deux cas de figure :
Dans le premier cas, le juge prononce la résiliation du contrat de travail du salarié. Les effets sont les mêmes que ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire un licenciement injustifié. A noter que dans des cas de harcèlement ou concernant des salariés protégés, les effets de la résiliation seront ceux d’un licenciement nul, c’est-à-dire annulé par le juge en raison des motifs du licenciement.
Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
Dans le second cas, le juge ne fait pas droit à la demande de résiliation. Le contrat de travail continue de courir dans les conditions contractuelles initiales.
Comment ce mode de rupture s’articule-t-il avec les autres options ?
Si le juge prononce la résiliation judiciaire du CDI, le salarié peut prétendre à diverses indemnités, à savoir :
- Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
- Indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ;
- Dommages et intérêts en suivant les règles prévues pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Ou, dans les hypothèses d’harcèlement ou de salariés protégés, le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
S'il s’agit d’un CDD, la résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture anticipée et abusive de l'employeur. En conséquence, le salarié pourra obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du CDD.
Quelle est la différence avec la prise d'acte ?
La prise d’acte est plus risquée pour le salarié : si le juge statue en défaveur du salarié, la prise d’acte sera requalifiée en démission, avec toutes les conséquences afférentes.
Dans le cadre d’une résiliation judiciaire, si le juge n’approuve pas les motifs invoqués par le salarié, le contrat de travail demeure et le salarié poursuivra son travail.
Comment ce mode de rupture s’articule-t-il avec les autres options ?
Dans l’hypothèse où le juge ne ferait pas droit à la demande de résiliation du salarié, le juge protège le salarié en cas de licenciement postérieur et proche dans le temps de l’action en résiliation judiciaire.
En cas de licenciement ultérieur à la demande de résiliation judiciaire, le juge doit d’abord rechercher si cette demande était justifiée. S’il estime la demande infondée, il statuera sur le bien-fondé du licenciement. Si la demande est fondée, la rupture du contrat de travail sera imputable à l’employeur. Le
licenciement prononcé ultérieurement par l’employeur sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En cas de démission postérieure à la demande de résiliation judiciaire, elle rend la demande initiale sans objet. Il sera éventuellement possible pour le salarié de demander la requalification en prise d’acte.
Pour plus d’informations, visiter le site service-public.fr.
> Télécharger la fiche n°45 - Fiche n°44 - La prise d'acte de la rupture du contrat de travail
-
Qu’est-ce que c’est ?
La prise d’acte de la rupture est un mode autonome de rupture du contrat de travail. A ce titre, le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut décider de rompre son contrat de travail en imputant la faute à son employeur. Ces manquements doivent, cependant, être de nature à être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Quelle est la procédure à suivre ?
La prise d’acte de rupture n’est possible que pour les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). Elle peut intervenir à tout moment excepté durant la période d’essai.
Aucune forme obligatoire n’est requise. Il convient toutefois pour le salarié, par un courrier écrit, d’imputer à l’employeur les raisons de sa prise d’acte de la rupture. En outre, le salarié doit adresser la prise d’acte directement à son employeur.
Une fois qu’il a pris acte de la rupture, le salarié doit saisir le conseil de prud’hommes (CPH) pour qu’il se prononce, dans un délai d’un mois, sur les effets de la rupture. A ce titre, les juges du fond appréhendent l’ensemble des manquements de l’employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans la prise d’acte de la rupture.
Quels sont les effets ?
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et ne peut pas, en principe, être rétractée, sauf accord des parties.
La prise d’acte de la rupture du contrat peut entraîner deux types d’effets alternatifs selon que le juge considère la prise d’acte de rupture du salarié comme justifiée. La prise d’acte est justifiée lorsque le salarié peut invoquer un manquement grave de l’employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
➔ Si la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul en cas de harcèlement, discrimination ou dans l’hypothèse où le salarié est protégé (à titre d’exemple, les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel bénéficient de ce statut de salarié protégé).
➔ A l’inverse, si la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produira les effets d’une démission.
Quels sont les droits du salarié ?
Dans l’hypothèse où la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit aux indemnités attachées à ce type de rupture.
A l’inverse, quand la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission, le salarié ne dispose d’aucune indemnité de rupture. De surcroît, il peut se retrouver à devoir verser une indemnité compensatrice de préavis.
Pour plus d’informations sur ces indemnités, consulter le site service-public.fr.
Que se passe-t-il ensuite ?
Suite à la réception de la notification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié les documents relatifs à la rupture. Cela lui permet de faire valoir ses droits. Il doit remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation pour l’assurance chômage.
Comment ce mode de rupture s’articule-t-il avec les autres options ?
Tout acte de l’employeur, postérieur à la prise d’acte par le salarié, est sans incidence sur le caractère justifié de la rupture. Ce dernier dépend seulement des griefs invoqués par le salarié.
> Télécharger la fiche n°44 - Fiche n°43 - Que faire en cas de plagiat d'une création ?
-
Qu'est ce que le plagiat ?
L’article L.122-4 du Code de la Propriété intellectuelle définit le plagiat comme la reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre d’un auteur et cela sans le consentement de ce dernier, ou de ses héritiers. Cette pratique illicite concerne avant tout les œuvres littéraires et artistiques. Des méthodes diverses telles que la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque peuvent également être touchées (par ex. L’adaptation (pièce de théâtre, film) ou la représentation d’une œuvre (peinture, sculpture, etc.), même originale, effectuée sans le consentement de l'auteur peut constituer une contrefaçon).
L’utilisation de textes, photographie ou vidéo sans citation ou référence à leur auteur d’origine est donc illégale. Néanmoins, certaines exceptions subsistent et la copie de l'œuvre d'autrui est licite lorsqu'elle est justifiée par l'exception de courte citation, la parodie ou la caricature par exemple. En France, le droit d’auteur est principalement détenu par une personne physique créatrice. Une personne morale pourra tout de même être titulaire de droits d’auteur lorsque ceux-ci auront fait l’objet d’une cession contractuelle avec la personne physique créatrice.
Quelles sont les actions possibles pour la victime de plagiat ?
1. Démontrer l’existence d’une antériorité
La principale difficulté en cas de plagiat est de prouver l’existence d’une antériorité et des droits de titularité sur l'œuvre en question. Cette étape peut s'avérer parfois difficile, notamment en cas de plagiat sur internet. Pour ce faire, il faut réunir les preuves relatives à l’œuvre originale permettant de démontrer que la personne est titulaire de droits sur l'œuvre plagiée et qu’elle est protégée (photo originale en haute définition, document datés justifiant de la création, horodatage, enveloppe Soleau etc.)
2. Collecter des preuves du plagiat
Lorsque l’auteur constate qu’une l’une de ses œuvres fait l’objet d’un plagiat, il convient également de se constituer des preuves que cette copie contrefait bien une œuvre originale antérieure. En cas de plagiat sur internet, des captures d’écran peuvent être effectuées. De manière plus formelle, un constat peut aussi être réalisé par un huissier de justice. Ce dernier pourra notamment être utile en cas de contentieux éventuel afin de faire cesser les agissements causant un préjudice et d’obtenir réparation.
3. Prise de contact avec l’auteur du plagiat
Dans le cas où l’auteur de l'œuvre plagiée est facilement identifiable, il est possible de contacter ce dernier (par email par exemple) afin de l’informer de vos droits et des risques encourus si l'œuvre en cause continue d’être diffusée. Cette démarche peut constituer une première approche amiable avant d’adresser une mise en demeure par courrier recommandé, plus formelle.
4. Agir juridiquement
Tous les créateurs d’une création originale sont protégés par le droit d’auteur. En dernier recours, lorsque les tentatives amiables ont été infructueuses, vous disposez toujours de la possibilité de porter plainte. Ce dépôt de plainte permettra également de saisir le tribunal compétent par la suite afin de faire valoir vos droits en tant qu’auteur de l'œuvre.
Quelles sanctions et conséquences entraine le plagiat ?
Le plagiat, selon son niveau de gravité, est caractérisé comme une contrefaçon. Pénalement, les sanctions peuvent être élevées. En effet, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient que la contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Sur le plan civil, des dommages et intérêts peuvent également être prononcés à l’encontre du plagiaire afin de réparer le préjudice économique et moral de l’auteur.
Enfin, des sanctions disciplinaires peuvent être encourues par le plagiaire en fonction de la gravité du plagiat. A titre d’exemple, un étudiant plagiant les recherches d’un autre étudiant peut se voir encourir des sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive. De même, cette sanction peut entraîner la perte du financement de leur recherche pour les chercheurs, voire le licenciement dans le secteur privé.
Dans certaines situations, le plagiat peut nuire à la réputation de son auteur. Il convient donc d’être très vigilant en cas de reprise de contenu protégé par le droit d’auteur et de garder le réflexe de citer les sources faisant l’objet de chaque travail.
> Télécharger la fiche n°43 - Fiche n°42 - Exercer son droit à l'oubli en matière de données personnelles
-
Qu'est ce que le droit à l'oubli ?
Toute personne doit pouvoir exercer un contrôle sur les données qui la concernent.
Le droit à l’oubli, aussi appelé droit à l’effacement, permet à un individu de demander l’effacement des données personnelles qui le concernent. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), ce droit est applicable dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne.
Le droit à l’oubli se distingue du droit d’opposition, également prévu par le RGPD, qui permet à l’individu de s’opposer, à tout moment, au traitement des données personnelles le concernant, sans pour autant que celles-ci ne soient supprimées. Le droit à l’oubli et le droit d’opposition peuvent être utilisés simultanément pour plus d’efficacité.
Dans quelle situations exercer son droit à l'oubli ?
Afin d’exercer son droit à l’oubli, la personne doit justifier sa demande par l’un des motifs suivants :
→ les données traitées ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été initialement collectées ou traitées (par ex. à la suite de la résiliation d’un contrat) ;
→ la personne concernée retire son consentement initialement donné dans le cadre du traitement ;
→ la personne concernée s’oppose au traitement de ses données et le responsable du fichier n’a pas de motif légitime de s'y opposer (par ex. une association des professionnels de la santé, investie d’une autorité officielle pour le faire, qui prend des mesures disciplinaires à l’encontre de certains de ses membres dispose d’un motif légitime) ;
→ les données sont traitées de façon illicite (par ex. publication de données piratées) ;
→ les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale (par ex. dans le cadre d’un recrutement les données des candidats doivent être supprimées au plus tard 2 ans après le dernier contact) ;
→ les données ont été collectées lorsque la personne était mineure (par ex. sur un blog, forum, réseaux sociaux, etc.).
Cependant, le droit à l’oubli n’est pas absolu. Le RGPD et la loi française restreignent son exercice dans plusieurs cas. La personne qui fait l’objet d’un traitement de données personnelles ne peut pas s’y opposer lorsqu’il est réalisé :
→ aux fins de la constatation de droits en justice (par ex. l’utilisation d’informations personnelles dans le cadre d’un procès entre un salarié et son employeur) ;
→ aux fins de création d'archives dans l'intérêt public (par ex. une base de donnée archivant des informations sur les patients atteints d’une certaine pathologie médicale) ;
→ aux fins d’informations concernant l’identité de personne morale (par ex. le nom et prénom du dirigeant d’une entreprise) ;
→ au respect d’une obligation légale par le responsable de traitement (par ex. le délai de conservation de 10 ans pour une facture) ;
→ au respect de motifs d’intérêts public dans le domaine de la santé publique (par ex. pour favoriser les études, les recherches ou les évaluations sur une maladie particulière) ;
→ à l’exercice de la liberté d’expression et d’information du responsable de traitement (par ex. le nom et le prénom de la personne sont cités au sein d’un article de presse),
→ à l’exercice du droit du public d’avoir accès à l’information.
Comment exercer son droit à l'oubli ?
La Commission Nationale Informatique et des Libertés (CNIL) explique la démarche à suivre.
→ Identifiez l’entreprise puis rendez-vous sur la page d’information réservée à l’exercice de vos droits sur le site internet de l’organisme (« politique confidentialité », « politique vie privée », « mentions légales ») afin de connaître la procédure mise en place par celle-ci.
→ La demande peut être adressée à l’organisme ou l’entreprise par voie électronique (formulaire, adresse mail, bouton de téléchargement etc.) ou par courrier.
→ Il est très important de lister précisément quelles sont les données concernées (nom, prénom, email, adresse, etc.). Pour avoir connaissance des informations précises détenues par l’entreprise ou l’organisme public, une demande de droit d’accès prévue par l’article 15 du RGPD peut notamment être effectuée préalablement à la demande de droit à l’oubli.
→ Si l’organisme à des doutes raisonnables sur votre identité, il peut vous demander de joindre tout document permettant de prouver votre identité.
Il est conseillé de conserver une copie des démarches.
Une fois la demande formulée, l’organisme public ou l’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour traiter la demande et apporter une réponse à celle-ci. En fonction des données concernées, la réponse pourra être positive ou négative.
Quels sont les effets de la demande de droit à l'oubli ?
Le responsable de traitement qui détient les données personnelles doit procéder à leur effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois mois selon la complexité de la demande dès lors que celle-ci est justifiée par un motif légitime apprécié par la CNIL si elle est saisie.
Quel recours exercer en cas de refus ?
Le responsable du traitement qui décide de ne pas donner suite à une demande d’exercice du droit à l’effacement se voit dans l’obligation de justifier son refus auprès du propriétaire des données. Il peut notamment se fonder sur un des motifs énoncés précédemment.
En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, le dépôt d’une plainte en ligne auprès de la CNIL est possible. Elle se prononcera dans un délai de 3 semaines à compter de la demande. La saisine de la CNIL est gratuite.
> Télécharger la fiche n°42