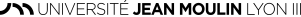Dans la même rubrique
Accueil :
- Accueil FR
- Publications
- Les fiches courtes
Les fiches de la Clinique 3/11
- Fiche n°83 - Les obligations des parties dans un contrat d’assurance
-
Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance ?
C’est un contrat dans lequel une personne verse une somme d’argent à un assureur afin de garantir un sinistre. En contrepartie, lorsque le sinistre survient, l’assureur lui versera une indemnité.
Comme dans tout contrat, les parties sont soumises à des obligations distinctes : les obligations relatives au risque ; les obligations relatives aux prestations promises ; les obligations relatives au sinistre.
Quelles sont les obligations du souscripteur relatives au risque ?
Le risque, c’est l’évènement aléatoire dont la survenance menace l’assuré (c’est-à-dire la personne menacée par le risque couvert), et qui est garanti par l’assureur.
Le souscripteur (celui qui conclut le contrat d’assurance) a l’obligation de déclarer le risque, c’est-à-dire l’évènement aléatoire dont il demande la garantie, à l’assureur.
Comment déclarer le risque avant la conclusion du contrat ?
Le souscripteur doit, dans un premier temps, déclarer le risque en répondant de façon exacte aux questions que lui pose l’assureur, lesquelles doivent être claires et précises. Le souscripteur qui fait de fausses déclarations s’expose à des sanctions.
- Par exemple, l’assureur peut demander au souscripteur d’une assurance automobile s’il a déjà commis une infraction au code de la route au cours des 5 dernières années.
- Une question claire et précise pour la souscription d’une assurance santé peut également être : « prenez-vous quotidiennement des médicaments ? » Si le souscripteur répond non alors que c’est le cas, c’est une fausse déclaration.
Comment déclarer une aggravation du risque en cours de contrat ?
Le souscripteur a l’obligation d’avertir l’assureur de toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque déjà déclaré ou crée un nouveau risque, au risque de rendre inexactes ou fausses les réponses aux questions posées au moment de la conclusion du contrat.
Cette déclaration doit se faire dans un délai de 15 jours à partir du moment où le souscripteur a connaissance de ces circonstances aggravantes nouvelles. En l’absence de déclaration, le souscripteur s’expose à des sanctions.
A quoi les parties s’engagent-elles ?
Une fois le contrat conclu, chaque partie est engagée : le souscripteur doit régler la prime à l’assureur ; l’assureur doit, en cas de réalisation du risque garanti, indemniser suivant les termes du contrat.
Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la prime ?
Le souscripteur doit régler la prime à l’assureur selon les modalités prévues par le contrat. À défaut, l’assureur peut mettre fin au contrat.
Toutefois, en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur doit respecter une procédure spécifique :- D’abord, il doit attendre 10 jours après le défaut de paiement de la prime pour mettre en demeure le souscripteur et l’avertir de la suspension de la garantie s’il ne paye pas la prime dans les 30 jours. Cette mesure vise à inciter le souscripteur à s’exécuter.
- Si le souscripteur ne paye pas la prime dans les 30 jours suivant la mise en demeure, la garantie sera suspendue : en cas de survenance de l’évènement redouté, l’assuré (la personne menacée par le risque couvert) ne sera plus couvert.
- Enfin, si l’assureur a bien mentionné dans la mise en demeure qu’il se réserve le droit de résilier le contrat en cas de non-paiement de la prime, il pourra mettre fin au contrat dans les 10 jours suivant la suspension de la garantie.
Que doit faire l’assuré en cas de survenance du sinistre ?
En cas de réalisation de l’évènement redouté et pour obtenir de l’assureur le versement de la somme d’argent promise, l’assuré doit l’informer de la survenance du sinistre. Il doit respecter certains délais pour bénéficier de la garantie :
- L’assuré doit avertir l’assureur du sinistre dans un délai de 5 jours à partir du moment où il a connaissance du sinistre.
- Ce délai est réduit à 2 jours en cas d’assurance vol : il doit avertir l’assureur du vol dans un délai de 2 jours à partir du moment où il en a connaissance.
Attention, le contrat d’assurance peut stipuler des délais différents, mais seulement au bénéfice de l’assuré. En d’autres termes, le contrat ne peut pas prévoir de délai plus court que 5 jours (ou 2 jours en cas de vol).
Fiche clinique réalisée par Antoine SEMET, Cassandre COLOMER et Gustina MATONDO - Fiche n°82 - L'hypothèque
-
Qu’est qu’une hypothèque ?
L'hypothèque est un mécanisme qui permet à une personne, le débiteur, d’obtenir un prêt (d’argent) ou de rembourser une dette (tels que les impôts impayés par exemple) en offrant un de ses biens immobiliers en garantie à son créancier. Ce bien peut être une maison ou un terrain.
Le bien hypothéqué reste-t-il la propriété de la personne durant l’hypothèque ?
Oui, la personne reste propriétaire de son bien, malgré l’hypothèque. Elle peut l’utiliser, en disposer (le vendre, le louer) et en tirer des bénéfices.
Quelles sont les parties impliquées dans l’hypothèque ?
Les parties impliquées dans l’hypothèque sont :
- Le créancier (une banque ou un particulier) : celui à qui profite l’hypothèque en cas de non paiement par le débiteur de la somme due.
- Le débiteur (un particulier ou une société) : celui qui donne son bien en garantie.
Que permet l’hypothèque ?
Ce mécanisme permet au créancier de bénéficier d’un droit de préférence : il sera payé prioritairement sur le bien immobilier donné en garantie dans le cas où le débiteur manquerait de payer ses dettes et aurait d’autres créanciers.
L’hypothèque confère également un droit de suite en cas de vente du bien. Cela permet au créancier de se payer sur le bien hypothéqué quel qu’en soit le nouveau propriétaire.
Existe-t-il plusieurs hypothèques ?
Oui, il existe des hypothèques de différentes natures :
- Les hypothèques conventionnelles
- Les hypothèques légales
- Les hypothèques judiciaires
Qu’est ce que l’hypothèque conventionnelle ?Cette hypothèque repose sur un contrat conclu entre le créancier et le débiteur.
Pour constituer une hypothèque conventionnelle il est nécessaire de :- Faire estimer le bien immobilier, par un expert immobilier ou un notaire.
- Désigner un créancier afin de savoir à qui profite l’hypothèque.
- La rendre officielle en passant par un notaire qui établira un acte notarié (document spécial). Ce document doit décrire exactement l’immeuble concerné.
- La rendre publique en l'inscrivant au service de la publicité foncière, pour qu’elle soit connue de tous.
Qu’est ce que l’hypothèque légale ?Elle est accordée de plein droit par la loi au créancier. Ce dernier bénéficie de l’hypothèque sans avoir à accomplir une démarche particulière ou à obtenir une décision préalable par un tribunal.
C’est l’exemple de l’hypothèque légale des mineurs ou majeurs sous tutelle. Les biens du tuteur sont automatiquement hypothéqués afin de garantir une bonne gestion du patrimoine des personnes placées sous sa protection. Si ce n’est pas le cas, les biens du tuteur seront saisis.
Qu’est ce que l’hypothèque judiciaire ?
Cette hypothèque est prise en urgence et de façon provisoire pour protéger les droits du créancier. À cette fin, le créancier doit avoir demandé au tribunal l’autorisation de constituer une hypothèque sur un des biens du débiteur.
Que signifie le terme provisoire ?
Cette inscription est qualifiée de provisoire car elle demeure dans l’attente d’une confirmation définitive de l’existence de la créance par le juge.
Si le créancier dispose d’une reconnaissance de dette, qui est un document attestant que le débiteur reconnaît sa dette, le créancier pourra inscrire l’hypothèque provisoire sans l’autorisation du juge afin de la rendre définitive.
Est-ce que toutes les hypothèques font l’objet d’une publication au service de la publicité foncière ?
L’hypothèque légale et l’hypothèque judiciaire, tout comme l’hypothèque conventionnelle, doivent faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Comment l’hypothèque peut-elle s’éteindre ?
L'hypothèque peut s'éteindre :
- Lorsque le débiteur rembourse sa dette.
- Lorsque le créancier renonce à celle-ci.
- Au bout de 30 ans car c’est la durée maximale autorisée pour laquelle elle peut rester inscrite.
Comment l’hypothèque est-elle mise en œuvre ?
Dans le cas où le débiteur ne s’acquitte pas entièrement de sa dette, son bien pourra être saisi afin de permettre au créancier de se rembourser. Une vente forcée sera alors réalisée :
- Soit la vente du bien permettra de rembourser totalement le créancier et de lever l’hypothèque.
- Soit la vente du bien ne suffira pas à rembourser intégralement la dette. Dans ce cas, le débiteur demeure tenu de rembourser le restant dû au créancier.
Est-ce que l’excédent de la vente revient au débiteur ?
Si la vente couvre entièrement la dette et génère un excédent, celui-ci revient au débiteur. Le créancier ne perçoit que le montant dû par le débiteur. Par exemple, le débiteur à un prêt de 500 000 euros, et il n’a remboursé que 200 000. Le créancier procède à la vente forcée du bien afin d’être remboursé intégralement. Le prix de vente est fixé à 600 000 euros. Sur ces 600 000 euros, le créancier n’aura que 300 000 euros car c’est la somme lui restant due. Les 300 000 euros restants reviendront au débiteur.
Quels sont les mécanismes à ne pas confondre avec l’hypothèque ?
La différence entre l’hypothèque et le gage :
Ces deux mécanismes ont en commun de consister à donner un bien en garantie. Cependant, l’hypothèque concerne un bien immobilier, tel qu’un terrain. Le gage porte sur un bien mobilier, comme un bijou.
La différence entre l’hypothèque et le cautionnement :
L’hypothèque constitue une garantie sur un bien tandis que le cautionnement engage personnellement un tiers (la caution) à assumer la dette du débiteur. Ce mécanisme est développé dans une autre fiche explicative : https://cliniquejuridique.univ-lyon3.fr/les-fiches-courtes.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’hypothèque ?
Les avantages liés à la constitution d’une hypothèque :
La constitution d’une hypothèque offre une sécurité au créancier qui est plus sûr d’être payé du montant qu’il aura initialement prêté.
Les inconvénients liés à la constitution d’une hypothèque :
- Si le bien perd de la valeur, la garantie est réduite d’autant.
- Si le prêt n'est pas remboursé, le bien sera saisi et vendu.
- Les frais de notaire, souvent onéreux, sont également à comprendre dans le prix de l’hypothèque. Ceux-ci oscillent généralement entre 0,5 et 7 % du prix du bien (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54267).
Fiche clinique réalisée par Cassandre COLOMER, Gustina MATONDO et Antoine SEMET - Fiche n°81 - Le droit de rétention : une personne peut-elle refuser de vous restituer votre bien ?
-
Qu’est-ce que le droit de rétention ?
C’est le droit reconnu à un créancier (le rétenteur) de refuser de restituer le bien qui lui a été remis, tant que le débiteur ne l’a pas payé. Ce créancier peut garder le bien aussi longtemps qu’il n’a pas été payé par le débiteur. Ce droit est une forme de garantie pour le créancier.
En revanche, le rétenteur ne peut pas vendre le bien pour se payer prioritairement aux autres créanciers. De plus, le rétenteur perd son droit de rétention lorsqu’il se sépare du bien. La rétention doit être continue pour être valablement exercé.
L’exemple type est celui du garagiste qui refuserait de restituer la voiture de son client tant que celui-ci n’a pas intégralement payé.
Quelles sont les conditions pour qu’existe un tel droit ?
Les conditions d’application du droit de rétention sont au nombre de trois. Elles sont cumulatives :
- Une créance : elle doit être née avec l’accord des deux parties. Elle doit être exigible, c’est-à-dire que le créancier doit pouvoir en réclamer le paiement. Son montant de cette dernière doit être connu et déterminé ou au moins déterminable.
- Une détention : le bien détenu par le créancier doit être dans le commerce juridique. Autrement dit, les choses dont la loi autorise le commerce. (Exemple : une voiture est dans le commerce juridique alors que le corps humain ne l’est pas). Il n’est pas non plus possible de retenir un bien qui porterait atteinte aux droits fondamentaux d’une personne (exemple : le chien guide d’une personne malvoyante). Le créancier doit retenir la chose de façon matérielle.
- Un lien de connexité entre la créance et la détention : il ne suffit pas au créancier de détenir un bien, encore fautil que la détention soit née de la créance. La connexité peut résulter du lien fait entre la créance et la chose retenue. (Exemple : vous vendez votre voiture, mais l’acheteur n’a pas encore payé, vous conservez la voiture jusqu’au payement). La connexité peut résulter de la créance impayée née à l’occasion de la détention de la chose. (C’est l’exemple du garagiste). Enfin, la connexité peut résulter du contrat lui-même, le droit de rétention serait alors contractuellement organisé (exemple : un contrat de gage).
En cas de non-respect des conditions du droit de rétention, le créancier qui conserverait à tort un bien s’expose à des sanctions pénales, notamment sur le fondement de l’abus de confiance qui est punissable de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Quelles sont les conséquences du droit de rétention ?
- À l’égard du débiteur : lorsqu’il est valablement exercé, le droit de rétention permet au créancier de refuser de restituer son bien au débiteur jusqu’à ce que ce dernier paye l’intégralité de la créance. Ce droit de rétention est indivisible de sorte qu’un payement partiel ne suffit pas à éteindre le droit de rétention.
- À l’égard des tiers : le droit de rétention est opposable à tous. Tant que le rétenteur conserve valablement le bien, il peut refuser de le restituer au débiteur comme à des tiers qui seraient le véritable propriétaire du bien, l’acquéreur du bien ou d’autres créanciers du débiteur disposant de sûretés sur le bien retenu. Les tiers ne pourront obtenir la restitution du bien que si la créance est payée, soit par eux-mêmes, soit par le débiteur.
Fiche clinique réalisée par Angèle Folie-Desjardins, Louise Lapière et Lucante Lebailly - Fiche n°80 - La protection de l’entrepreneur individuel, mythe ou réalité ?
-
Le statut d’entrepreneur individuel est une option pour celui qui se lance dans l’entrepreneuriat. Il est simple à mettre en place et facile à utiliser.
Qu’est-ce qu’un entrepreneur individuel ?
La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante le définit comme une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Quelle est la principale différence entre ce statut et celui de l’EIRL ?
Avant la loi de 2022, il était possible pour l’entrepreneur d’opter pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Ce statut permettait à l’entrepreneur individuel d’affecter des biens dans un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.
La loi de 2022 est venue supprimer le régime de l’EIRL afin de mettre en place celui de l’entrepreneur individuel. Dans cette configuration, l’entrepreneur dispose toujours de deux patrimoines différents avec d’une part un patrimoine professionnel et de l’autre un patrimoine personnel. Toutefois, contrairement à l’EIRL, il n’a plus besoin d’exercer la moindre démarche pour effectuer la séparation des patrimoines. Cette dernière intervient automatiquement par l’effet de la loi.
Quels sont les biens qui composent les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur ?
D’une part, les biens entrant dans le patrimoine professionnel sont listés par l’article R.526-26 du Code de commerce. Ce sont les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui peuvent s’avérer utiles à son activité professionnelle. Ce sont, par exemple, les fonds de commerce et les fonds artisanaux, la marchandise, le matériel d’outillage, les biens immeubles servant à l’activité professionnelle ou encore les biens incorporels tels que les licences, les marques ou les enseignes.
D’autre part, l’article L.526-22 du Code de commerce indique que le patrimoine personnel se compose de tout ce qui n’est pas inclus dans le patrimoine professionnel. C’est le cas, par exemple, d’une résidence secondaire, d’un tableau de grand maître ou encore d’une voiture non affectée à l’usage professionnel.
Est-ce que la séparation des patrimoines professionnel et personnel est efficace ?
La scission des patrimoines que prévoit ce statut est peu efficace. En effet, l’entrepreneur peut renoncer à la séparation automatique des patrimoines prévue par la loi.
Le cas le plus fréquent est celui de l’entrepreneur qui renonce à la séparation de ses patrimoines afin d’obtenir du crédit auprès des banques. En réunissant ses patrimoines, il offre de meilleures garanties à la banque et augmente ses chances d’obtenir un crédit.
À noter que la renonciation à la séparation des patrimoines ne peut se faire qu’au profit d’un créancier particulier et pour un acte en particulier (interdiction de faire une renonciation générale).
Quels sont les régimes d’imposition offerts à l’entrepreneur individuel ?
Il existe deux grands régimes d’imposition en France : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Parce que l’entrepreneur individuel exerce en principe son activité professionnelle en son nom propre, le législateur a prévu que ce dernier reste soumit à l’impôt sur le revenu (l’assiette imposable dépend alors du chiffre d’affaires qu’il réalise, déduction faite des charges sociales, fiscales et commerciales).
Toutefois, l’entrepreneur individuel peut opter pour le régime d’impôt sur les sociétés en demandant à être assimilé à une EURL (forme de société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé unique).
Quels sont les avantages du statut d’entrepreneur individuel par rapport à une société ?
Outre les aspects fiscaux évoqués précédemment, l’entreprise individuelle se caractérise par sa simplicité, tant au stade de sa création qu’à celui de son fonctionnement.
L’entrepreneur individuel dirige seul son activité professionnelle sans avoir à rendre des comptes à des associés ou à un organe de direction.
De plus, l’entrepreneur individuel n’est pas tenu de délivrer un capital social, c’est-à-dire de doter son entreprise d’une somme d’argent minimale afin de démarrer son activité.
Est-il possible de transmettre une entreprise individuelle ?
La transmission est possible mais demeure difficile.
Fiscalement, la transmission de l’entreprise individuelle est assimilée à une cessation d’activité. L’entrepreneur individuel va devoir s’acquitter de toutes les charges qui pesaient sur lui au moment de la transmission à son successeur.
De plus, comme l’entreprise individuelle constitue un tout composé d’éléments incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, enseigne, brevet) et corporels (outillage, matériel), elle ne peut être transmise que dans sa totalité. À l’inverse, les droits sociaux d’une société présentent l’avantage de pouvoir être transmis progressivement. Ainsi, il peut être plus intéressant de transformer son entreprise individuelle en société avant d’envisager de la transmettre.
Que se passe-t-il en cas de cessation totale de l’activité par l’entrepreneur ?
La cessation totale de l’activité entrepreneuriale intervient du fait de l’entrepreneur ou du fait de son décès.
La cessation totale d’activité met fin à l’existence du patrimoine professionnel. Ce dernier rejoint le patrimoine personnel. Les droits des créanciers professionnels impayés à la date de cessation d’activité vont alors pouvoir s’exercer sur le patrimoine personnel.
En cas de décès, la solution est similaire, à ceci près que le patrimoine professionnel passe aux héritiers de l’entrepreneur individuel, sauf à ce qu’ils renoncent à la succession.
Existe-t-il d’autres cas de figure où les patrimoines de l’entrepreneur peuvent être réunis ?
Les patrimoines de l’entrepreneur peuvent être réunis en cas de manœuvres frauduleuses ou de refus d’acquitter les sommes dont il est redevable.
Par exemple, en cas d’absence de paiement des impôts ou des cotisations sociales, les droits du Trésor public s’étendent aussi à son patrimoine personnel.
Fiche clinique réalisée par Gaëtan MUFFAT et Thibault DELECRAZ
- Fiche n°79 - Peut-on devenir propriétaire immobilier grâce à l’écoulement du temps ? Partie 2
-
De quoi parle-t-on ?
La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur du meuble d’en devenir propriétaire à l’expiration d’un certain délai. À la différence de la prescription des immeubles, le possesseur de meuble doit nécessairement être de bonne foi lors l’entrée en possession du bien.
Qu’est-ce qu’un meuble ?
Les meubles sont tous les objets tangibles qui sont susceptibles de déplacement sans modification ni destruction.
Quels sont les meubles qui peuvent faire l’objet d’une prescription ?
Tous les meubles ne peuvent pas faire l’objet d’une prescription. En sont exclus les meubles soumis à la publicité (les avions ou les bateaux), les meubles qui relèvent du domaine public, les meubles gagés et les meubles incorporels (un logiciel).
Quelles sont les conditions de la possession pour devenir propriétaire du bien meuble ?
Pour devenir propriétaire, la personne doit posséder le bien. Le possesseur du meuble doit exercer de manière effective les attributs de la propriété sur le bien (il doit assurer l’entretien du bien, par exemple) avec l'intention de se comporter comme et la croyance légitime d’être propriétaire. De plus, le possesseur doit avoir physiquement la main sur le meuble.
Ce dernier doit obligatoirement être de bonne foi lors de l’obtention du titre de propriété ou de l’entrée en possession. Puisque la bonne foi est présumée, le demandeur devra établir que le possesseur savait que le juste titre n’était pas valable pour récupérer le bien.
Quelles sont les exceptions au mécanisme ?
En cas de perte ou de vol, le véritable propriétaire peut revendiquer le bien pendant un délai de trois ans à compter de la date de la perte ou du vol.
Si le possesseur actuel de la chose l’a acquise dans une foire, un marché, ou une vente publique, la remise de la chose au propriétaire originaire est conditionnée au remboursement du possesseur.
Fiche clinique réalisée par Gaëtan MUFFAT et Thibault DELECRAZ - Fiche n°78 - Peut-on devenir propriétaire immobilier grâce à l’écoulement du temps ? Partie 1
- De quoi parle-t-on ?
En principe, le droit de propriété est imprescriptible : même à ne pas se servir d’un immeuble, on en demeure propriétaire.
Cependant, la prescription acquisitive ou usucapion permet à une personne qui possède un bien d'en acquérir la propriété par l’écoulement du temps sans versement d’un prix en contrepartie. L’usucapion est un moyen d'éviter les conflits entre le possesseur et le propriétaire d'origine ou ses héritiers en empêchant que les réclamations sur leur propriété ne puissent durer éternellement.
Qu’est-ce que la possession ?
La possession est un élément clé du mécanisme de l’usucapion. C’est le fait pour une personne d'exercer de manière effective les attributs de la propriété sur un bien (elle assure l’entretien du bien, par exemple) avec l'intention de se comporter comme et la croyance légitime d’être propriétaire. C’est pourquoi une personne qui détient le bien en sachant qu’elle n’est pas propriétaire (un locataire, par exemple) ne pourra pas acquérir la propriété par usucapion.
Quels sont les caractères requis de la possession pour usucaper ?
La possession doit être utile et de bonne foi.
La possession doit être utile. Cela suppose de réunir quatre conditions :
La possession doit être continue : exercée de manière régulière, sans interludes anormaux et assez prolongés.
La possession doit être paisible : le possesseur ne doit pas être rentré en possession ni la maintenir par la violence.
La possession doit être publique : elle doit être exercée de manière apparente pendant toute la durée de l’occupation du bien.
Enfin, la possession doit revêtir un caractère non-équivoque : il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur l'intention du possesseur de se comporter en propriétaire. Par exemple, une personne qui s’abstient d’assurer un bien contre les incendies ou de le réparer ne se comporte pas comme le propriétaire.
Aux termes de combien d’années peut-on acquérir la propriété possédée ?
Une distinction principale tient à la bonne foi du possesseur.
L'article 2272 du Code civil établit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Ce délai s'applique lorsque les conditions précédentes sont réunies mais que le possesseur n’est pas de bonne foi ni ne possède de juste titre.
Qu’est-ce que la bonne foi ?
La bonne foi est présumée, conformément à l'article 2274 du Code civil. Elle implique que le possesseur croit, au moment de l'acquisition, avoir obtenu le bien d'un véritable propriétaire.
Qu’est-ce que le juste titre ?
C’est un titre juridique translatif de propriété, tel qu’un contrat de vente. Ce dernier, s'il émanait du véritable propriétaire, entrainerait le transfert de propriété.
Si le possesseur acquiert un immeuble de bonne foi et avec un juste titre, la propriété lui est acquise par l’écoulement du délai d’une décennie.
Comment mettre en œuvre la prescription acquisitive ?
Le mécanisme de l’usucapion n’est pas automatique : l’écoulement du délai n’opère pas, de lui-même, attribution de la propriété. Une demande doit être introduite devant le tribunal. Le véritable propriétaire du bien pourra lui aussi saisir le tribunal pour demander la restitution de son bien.
Fiche clinique réalisée par Gaëtan MUFFAT et Thibault DELECRAZ - Fiche n°77 - Quels sont le rôle et les devoirs du notaire ?
-
Présentation
Qui est le notaire ?
Défini par la loi du 16 mars 1803 puis par l’ordonnance du 2 novembre 1945, le notaire est un conseiller impartial informant les parties de leurs obligations. En sa qualité d’officier public, il a pour mission principale de rédiger, d’authentifier et de conserver les actes juridiques en apposant son sceau.
Quel statut revêt le notaire ?
Le notaire est un officier public désigné par le Ministre de la Justice. Il est chargé par l'État d'accomplir une mission de service public et il est investi de prérogatives de puissance publique.
Le rôle et les missions du notaire
Quel est le rôle du notaire ?
En tant qu’officier public, le notaire joue un rôle d'authentification et de conservation des actes qu’il reçoit.
Authentification
Le notaire authentifie les actes qu'il établit. Ce faisant, il garantit le consentement libre et éclairé des parties afin de protéger leur accord. Il est responsable du service public de l'authenticité c’est-à-dire qu’il confère une force probatoire aux actes qu’il signe lesquels sont alors dotés de la force exécutoire (possibilité de recourir à la force publique pour faire exécuter l’acte).
L'acte notarié, une fois publié, devient opposable aux tiers. Il fait foi de l'identité des parties, du contenu et de la date, jusqu'à preuve de faux en écriture publique. Cette lourde procédure peut entraîner une amende de 10 000 euros et l’obtention d'éventuels dommages-intérêts.
L’évolution de la technologie permet maintenant aux notaires de procéder à la signature d'actes électroniques qui ont la même valeur juridique qu'un acte papier et possèdent la même force exécutoire qu'un jugement définitif.
C’est pour ces raisons que le notaire est, en quelque sorte, le magistrat de l’amiable, acteur d’une justice amiable.
Conservation
Le notaire assure la consultation et la conservation des actes pendant 75 ans (100 ans pour ceux qui concernent un mineur), après quoi les documents seront versés aux archives.
Pour quels actes contacter un notaire ?
Le notaire est un acteur important de la vie de ses clients, en effet, il est obligatoire d’avoir recours à ce dernier pour les actes suivants :
- Vente immobilière
- Contrat de mariage
- Pacte successoral
- Partage des biens d'une succession avec testament ou comportant des biens immobiliers
- Donation
- Acte de notoriété
- Acte de notoriété héréditaire
- Consentement à une procréation médicalement assistée
Quels sont les devoirs du notaire ?
Le notaire est tenu à une obligation de conseil envers ses clients : il doit leur fournir une information exhaustive et leur recommander les solutions les plus adaptées pour atteindre le résultat souhaité. La mission du notaire, guidé par le code de déontologie, implique également un devoir d’impartialité et de neutralité en toutes circonstances. Il ne peut pas avantager son client aux dépends de la partie adverse ou pour servir ses intérêts.
Le contrôle de mission du notaire
Bien que le notaire exerce une profession libérale, il est soumis à une supervision rigoureuse. Il est tenu par les dispositions légales et les normes déontologiques qui régissent son activité. Chaque notaire est affilié à un conseil régional ou interrégional des notaires, instances professionnelles responsables de garantir le respect de ces normes. Ces conseils disposent du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires en cas de manquement aux règles déontologiques.
Le procureur de la République, dans le ressort de la cour d’appel compétente, exerce une mission de contrôle sur la déontologie et la discipline notariale. En cas de soupçon de manquement déontologique, il peut solliciter les services d’enquête des juridictions disciplinaires.
Un client souhaitant formuler une réclamation à l'encontre d'un notaire doit s'adresser au président du conseil régional ou interrégional dont le notaire dépend.
Contacter un notaire
L'annuaire des notaires de France permet de trouver un notaire. Il n’est pas nécessaire qu’il soit proche du domicile du client car chaque notaire est compétent sur l’ensemble du territoire national. Le choix de son notaire n’est pas un choix définitif ; il est même possible de changer de notaire avant la signature de l'acte.
Quel coût ?
L’expression « frais de notaire » est couramment utilisée pour désigner les sommes versées au notaire lors d'une transaction immobilière ou du règlement d'une succession, par exemple. Toutefois, ces frais se composent en grande partie de taxes collectées par le notaire pour le compte du Trésor public, ainsi que de débours, c’est-à-dire des sommes dues à d'autres professionnels (tels que géomètres-experts, syndics, etc.). En réalité, seule une fraction de ces frais représente la rémunération propre et effective du notaire.
La rémunération des notaires se divise en deux catégories : les émoluments et les honoraires.- Les émoluments sont encadrés par le Code de commerce (L.444-1 et suivants) et déterminés par arrêté ministériel. Ce tarif, révisé tous les cinq ans, couvre la préparation et la rédaction d’actes notariés majeurs, tels que les ventes immobilières, prêts, donations, contrats de mariage, procurations, déclarations de succession et partages. Le tarif des émoluments est disponible sur le site internet des Chambres des notaires.
- Les honoraires concernent les prestations non couvertes par le tarif des émoluments. Ils s’appliquent principalement aux consultations juridiques et à divers actes (ex. : baux d’habitation ou commerciaux, actes de société, contrats commerciaux, compromis de vente, négociation ou gestion immobilières).
Comment sont-ils calculés ?
Les émoluments peuvent être proportionnels à la valeur brute exprimée dans l’acte, calculés par tranches selon la valeur des biens concernés (comme le prix d’un bien immobilier ou l’actif brut d’une succession), ou fixes pour certains actes spécifiques (ex. : actes de notoriété successorale, mainlevée d’hypothèque, contrats de mariage). Ce tarif est unique, uniforme et non négociable.
Les remises
La remise d’émolument
Une remise est possible mais elle est limitée par la loi. Lorsque le notaire accepte de l'accorder, sans y être obligé, il doit la proposer uniformément pour un type d’acte spécifique, avec un affichage clair dans son étude.
Remise d’honoraire
Contrairement aux émoluments, les honoraires sont fixés librement par le notaire, en accord avec le client et formalisés par une convention d’honoraires. Leur montant dépend du temps passé, de la complexité du dossier et de l’importance des intérêts en jeu.
Attention : En cas d’interruption de la mission par le client, le notaire conserve le droit de facturer les honoraires correspondant au travail déjà réalisé, même si la mission aurait normalement donné lieu à des émoluments.
Fiche clinique proposée par Gaëtan MUFFAT et Thibault DELECRAZ - Fiche n°76 - La mauvaise gestion du dirigeant associatif
-
Contexte
En France, les associations ont une place majeure dans la vie sportive, culturelle et civique. Elles ont également une place importante dans l’économie du pays, avec un budget global de 113 milliards d’euros en 2020, dont 23 milliards proviennent de subventions versées par les administrations publiques. En conséquence, leur bonne gestion est un enjeu majeur.
Qui sont les dirigeants associatifs ?
Le dirigeant de droit d’une association est le membre officiellement investi par les statuts d’un rôle de gestion ou de représentation de l’association. Sa désignation résulte d’une élection ou d’une nomination. Ses missions sont définies par les statuts ou la loi. Dans les faits, il s’agit généralement du président, du trésorier et du secrétaire général ou de tout autre membre du bureau.
Juridiquement, les dirigeants sont titulaires d’un mandat (Cass., Civ. 1ère, 5 février 1991, n°89-11.351). L’article 1984 du Code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne [ici, l’association] donne а une autre [ici, le dirigeant] le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Parfois, un membre de l’association exerce une activité de gestion et se comporte comme un dirigeant de droit sans avoir formellement été désigné comme tel. Il est alors qualifié de dirigeant de fait et sera tenu responsable comme un dirigeant de droit.
Comment l’association, en tant que personne morale, peut-elle engager la responsabilité du dirigeant ?
Lorsque le dirigeant associatif manque à ses obligations envers l’association, il engage sa responsabilité personnelle.
La première hypothèse de mauvaise gestion du dirigeant est l’inexécution de ses obligations. Tout mandataire est tenu de remplir les obligations conférées par son mandat.
En présence d’un dirigeant négligeant, il sera nécessaire de démontrer une inexécution de ses obligations et l’existence d’un préjudice pour engager sa responsabilité
Toutefois, cette hypothèse n’est que très rarement, pour ne pas dire jamais, mise en œuvre.
La seconde hypothèse de mauvaise gestion, et la plus courante, est celle de la faute de gestion, c'est-à-dire une faute compromettant les intérêts de l’association ou de ses membres.
Dans les associations, la faute de gestion la plus courante est la violation des statuts. En vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, chaque association souhaitant se doter de la personnalité morale est tenue de rédiger des statuts, dans lesquels doivent figurer des informations essentielles sur son fonctionnement et son organisation.
Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le trésorier d’une association réalisant des placements bancaires, alors que les statuts ne l’autorisaient pas à réaliser une telle opération, commettait une faute de gestion et devait être tenu de réparer du préjudice financier subi par l’association (Cass., Com., 11 février 2014, 13-10.067).
Il est toutefois important de noter qu’il existe une atténuation à la responsabilité du dirigeant. En effet, lorsque le dirigeant ne perçoit pas de rémunération, sa gestion est appréciée de manière moins rigoureuse que celle d’un dirigeant exerçant sa mission à titre onéreux.
Qui peut agir au nom de l’association contre le dirigeant ?
Seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. Dans le cas d’une association, seuls les organes désignés par les statuts peuvent exercer une action en justice en son nom. En pratique, il s’agit souvent du président de l’association.
Dès lors, il peut être opportun d’accorder un pouvoir de représentation à d’autres organes de l’association pour le cas où une action pourrait être engagée contre un dirigeant de celle-ci.
A défaut, les membres de l’association ne pourront pas agir en son nom. La Cour de cassation l’a confirmé en rappelant que si les textes autorisent l’exercice d’une telle action pour les associés d’une société, aucune disposition similaire n’est prévue au profit des membres d’une association (Cass., Civ. 3ème, 20 juin 2024, 23-10.571).
Attention, les associés peuvent toujours agir en leur nom personnel lorsque la gestion par le dirigeant leur a causé un préjudice personnel.
Comment peut-on destituer le dirigeant de ses fonctions ?
Pour destituer le dirigeant associatif de ses fonctions, il convient en premier lieu de se référer à la procédure établie dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Si ces textes ne prévoient aucune procédure spécifique, l’article 2004 du Code civil permet de révoquer le mandat décerné au dirigeant associatif.
L’organe ayant élu ou nommé le dirigeant (conseil d’administration, assemblée générale) est compétent pour adopter une délibération en ce sens suivant les règles de quorum et de majorité applicables à la décision ayant donnée mandat au dirigeant.
Attention, destituer un dirigeant de ses fonctions ne vaut pas exclusion de l’association. Le dirigeant destitué conserve la qualité de membre. Pour l’exclure de l’association, il convient de se référer à la procédure disciplinaire associative.
Est-ce que les membres de l’association, en tant que personnes physiques, peuvent engager la responsabilité personnelle du dirigeant associatif ?
En principe, en présence d’une faute du dirigeant causant un préjudice aux membres de l’association ou à des tiers, seule l’association, en tant que personne morale, peut être tenue responsable, le dirigeant n’étant qu’un mandataire.
Toutefois, lorsque le dirigeant commet une faute qui est détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Cass., Com., 20 mai 2003, 99-17.092), alors la victime du préjudice pourra rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant.
Le dirigeant associatif est-il pénalement responsable des actes commis dans l’exercice de ses fonctions ?
En présence d’une faute de gestion constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale de l’association pourra être recherchée, ce qui n’exclut pas la responsabilité des dirigeants (article 121-2 du Code pénal).
Lorsque l’infraction commise par le dirigeant l’a été afin de servir l’intérêt de l’association, alors seule cette dernière pourra voir sa responsabilité pénale engagée.
Toutefois, lorsque le dirigeant a usé de ses fonctions et pouvoirs afin de servir son intérêt personnel, sa responsabilité pénale sera engagée.
Dans cette matière, les infractions les plus récurrentes sont le détournement de fonds et l’abus de confiance.
Fiche clinique proposée par Matthieu BOUCHET, Thibault DELECRAZ et Alexandra BACHELET - Fiche n°75 - Comment détecter une escroquerie ?
-
Qu’est-ce qu’une escroquerie ? Elle est définie par l’article 313-1 du code pénal. L’escroquerie consiste pour l'escroc à obtenir un bien, un service ou de l'argent par une tromperie. L’auteur des faits doit avoir l’intention de tromper sa victime.
Par quels procédés l’auteur peut-il essayer de vous escroquer / tromper ?
L’escroquerie suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
Concernant l’élément matériel :
Il peut prendre plusieurs formes. L’auteur doit avoir utilisé l’un des procédés suivants pour vous tromper :- L’emploi d’un faux nom ou d’un faux prénom. Cela peut également porter sur un prénom. Il suffit que le nom utilisé ne soit pas celui de l’escroc, peu importe que ce nom soit réel ou imaginaire.
- L’emploi d’une fausse qualité. Cela peut être un titre ou un diplôme existant ou imaginaire. Pour pouvoir réaliser une escroquerie, la fausse qualité doit être suffisamment crédible pour pouvoir tromper. Par exemple, se faire passer pour un banquier pour soutirer des fonds à la victime.
- L’abus de qualité vraie. Cela correspond à un mensonge, non pas sur la qualité invoquée, mais sur les déclarations faites. Il est exigé que la qualité invoquée soit de nature à inspirer confiance pour que l’abus de cette qualité puisse avoir en conséquence un certain pouvoir trompeur. Par exemple, un notaire qui fait signer un compromis de vente subordonné à l'acquisition d'un autre immeuble en sachant que le propriétaire de cet immeuble refuse de le céder au prix indiqué
- Les manœuvres. Cela peut être des mensonges si elles sont accompagnées de faits extérieurs ayant pour but de donner de la force au mensonge. Par exemple, avec l’intervention d’un tiers ou la production de faux bilans.
Quel que soit le procédé employé pour réaliser l’escroquerie, cet acte doit avoir été déterminant dans la remise de votre bien, service ou argent à cette personne.
Concernant l’élément moral :
L’élément moral se traduit par le fait que l’auteur des faits ait eu l’intention de nuire à la victime. En effet, l’auteur doit avoir pleinement conscience de son acte c’est-à-dire d’agir pour tromper autrui. Cette preuve peut résulter des procédés de tromperie qu’il aura mis en place.
A titre exemple, un comptable qui atteste l’exactitude d’un bilan alors que celui est incorrect, sans en avoir connaissance, ne pourra pas être condamné pour escroquerie. En effet l’élément moral fait défaut, car le comptable n’avait pas l’intention de tromper la victime en certifiant l’exactitude du bilan ne sachant pas qu’il était faux.
A quoi ces procédés doivent-ils mener ?
Par l’usage de l’un de ces procédés, l’escroc vous incite à lui remettre des fonds ou valeurs. Cela peut être par exemple de l’argent ou des bijoux, ou des biens quelconques sans importance pour leur valeur, la fourniture d’un service ou le consentement d’un acte.
La remise doit être opérée par la victime et doit lui causer un préjudice qui peut être matériel ou moral. Par exemple, le préjudice est matériel si à cause de l’escroquerie la victime s’est appauvrie. En plus de cette perte financière, le préjudice est moral notamment lorsque la victime subit un choc émotionnel.
A quoi l’auteur d’escroquerie peut-il être condamné ?
L’article 313-1 du code pénal condamne l’escroquerie à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines.
Fiche rédigée par Elisa TRIOULAIRE, Margot BAUDILLON et Vanina LAFOND